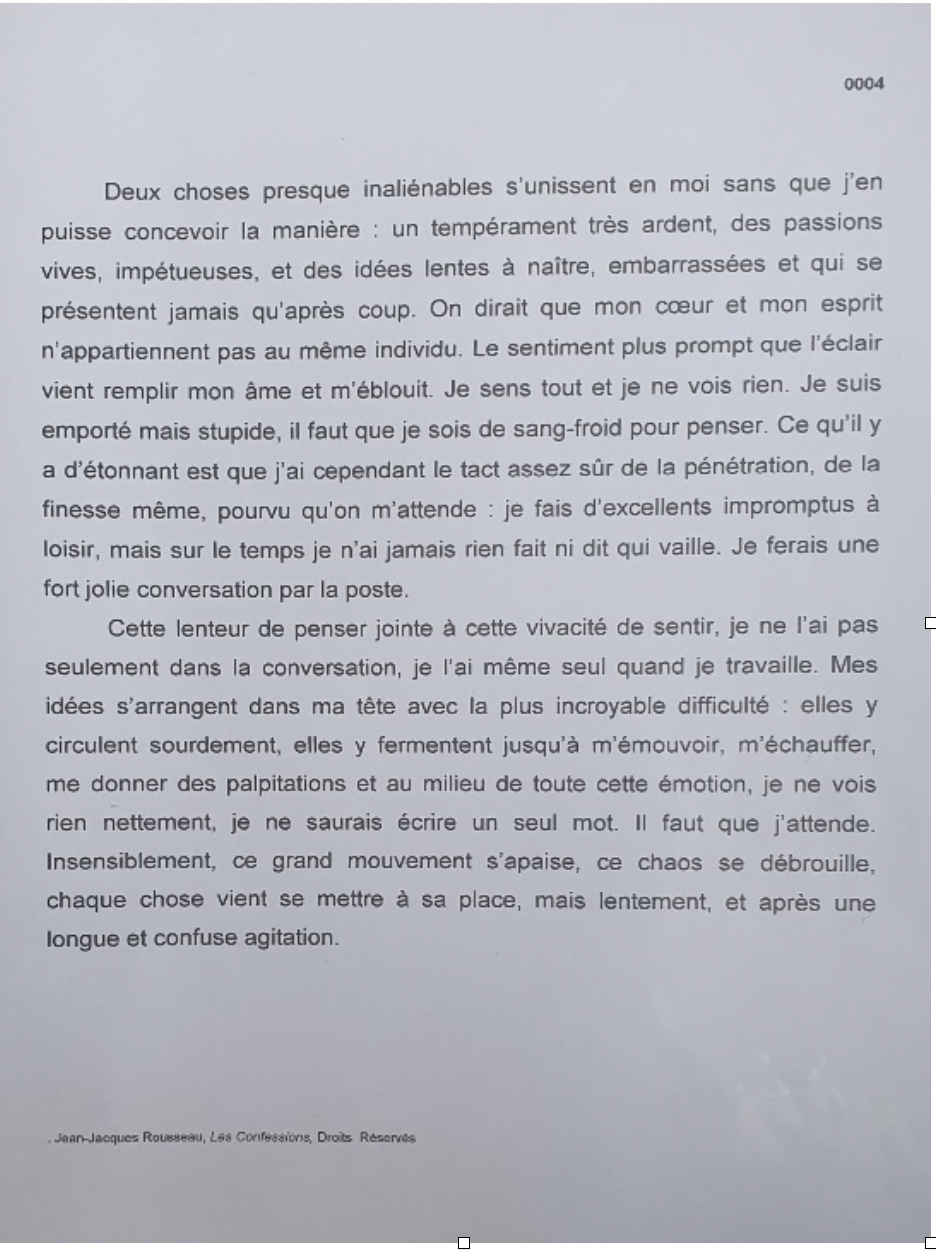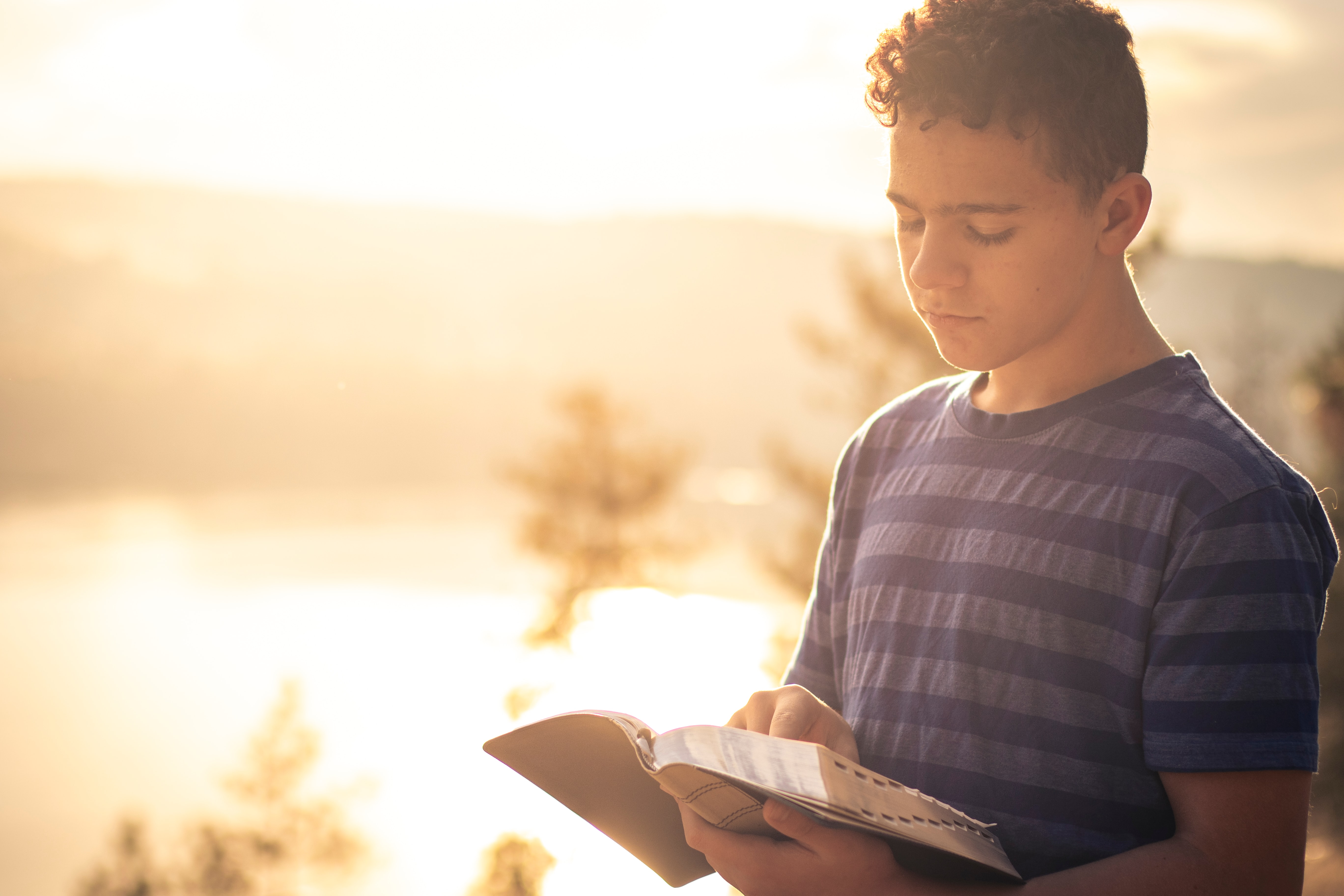Qu’est-ce que l’expression scénique ?
Cette méthode est née au début des années 1950-1960. Émile Dars (1901-1980), metteur en scene et professeur d’art dramatique constate alors que les rôles investis par les comédiens semblent avoir une influence sur leur psychisme. Il observe cet impact et en déduit que « ce n’est pas le comédien qui se met dans la peau du rôle, mais bien le rôle qui se met dans la peau du comédien », provoquant chez lui différents états émotionnels.
Petit à petit, l’expression scénique s’est dépouillée de sa dimension posturale, corporelle, de sa théâtralité. Elle s’oriente vers l’essentiel : le texte littéraire. Ce dernier, comme expérience de vie déjà élaborée, prédigérée par un auteur, induit des images et des émotions qui vont toucher, influencer le psychisme du lecteur. Il joue le role d’un masque derrière lequel le lecteur peut mieux dire et “se dire”.
La Société Française d’Expression Scénique, présentée sur le site Mélithem, assure la formation de scénothérapeutes depuis maintenant plus de 30ans. Leur « banque de textes » répertorie soigneusement plus de 800 extraits faisant partie patrimoine culturel français, allant du dialogue de théâtre à la poésie, en passant par les extraits de roman
En voici quelques exemples:
-
Pourquoi l’utiliser en orthophonie ?
Orthophonistes et psychologues utilisent la méthode afin de soutenir la part émotionnelle et affective de leurs patients. La richesse littéraire des textes offre des repères d’identité culturelle et supporte le développement de l’affirmation de soi.
En orthophonie telle que je la pratique, l’expression scénique est un relais de choix face aux thérapies plus classiques, pour des patients présentant
- Des troubles de la fluidité verbale : bégaiement, bredouillement…
- Des troubles de la voix
- Des troubles d’acquisition du langage écrit : dyslexie, dysorthographie
- Des troubles associés aux maladies neurodégénératives (mémoire, attention, langage)
- Un blocage psychoaffectif impliquant une inhibition de la pensée et/ou verbale.
Elle peut s’inscrire en alternance avec des soins classiques, ou bien dans leur prolongement.
Les contenus littéraires sont adaptés aux adolescents à partir du niveau collège, en fonction de leur compétence en lecture. Le bilan orthophonique initial réalisé en amont permet de l’objectiver.
-
Intérêt de la scénothérapie dans le contexte de la pandémie
L’adolescence est naturellement une période de la vie propice aux interrogations au plan existentiel, affectif, relationnel etc.
 Chez certains, déjà fragiles avant la pandémie, la santé mentale a pu se détériorer. L’enfermement avec les proches, la perte de liberté, la réduction des contacts extérieurs notamment avec les pairs, ont fragilisé les repères identitaires, psychoaffectifs et chronobiologiques, allant même parfois jusqu’à des états de souffrance.
Chez certains, déjà fragiles avant la pandémie, la santé mentale a pu se détériorer. L’enfermement avec les proches, la perte de liberté, la réduction des contacts extérieurs notamment avec les pairs, ont fragilisé les repères identitaires, psychoaffectifs et chronobiologiques, allant même parfois jusqu’à des états de souffrance.
L’expression scénique est une approche de choix puisqu’elle permet, en douceur, de mettre des mots sur des états de frustration, des manques vécus au quotidien, des conflits (internes et externes) générés par cette période si particulière.
-
Un cadre thérapeutique précis
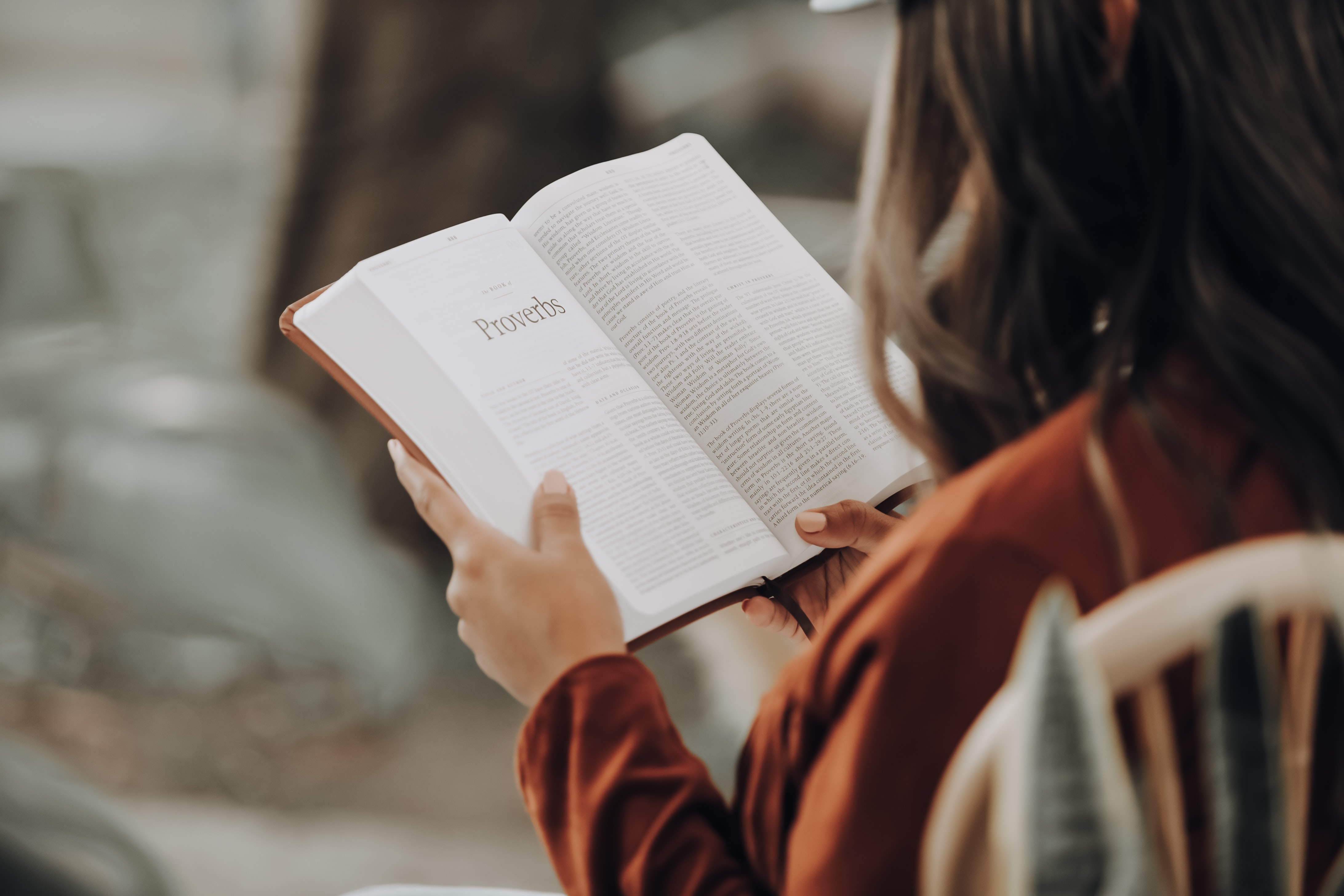 Il rassure le patient tout en garantissant une progression optimale.
Il rassure le patient tout en garantissant une progression optimale.
Le bilan orthophonique initial permet de cerner les difficultés ainsi que les atouts de mes patients au plan langagier et attentionnel.
Si les difficultés entrent dans le cadre des troubles décrits précédemment, je peux décider de proposer une période de soins utilisant l’expression scénique.
Ensemble, le patient et moi, nous définissons alors
1/ une période de sensibilisation à la méthode, sur 4 séances espacées d’une semaine, suite à laquelle le patient décide de continuer ou non ;
2/ une période de soins qui fait suite à la période de sensibilisation, d’une durée de 4 à 6 mois ;
3/ la durée des séances, de 45 mn à 1 heure (et plus si nous décidons de prolonger le travail autour des textes à l’écrit) ;
4/ un lieu, un horaire et un rythme (une séance par semaine est recommandée) dont la régularité est essentielle.
-
Une consigne claire, mais souple
Elle s’adapte aux capacités langagières et attentionnelles du patient (évaluées lors du bilan initial).
A titre d’exemple, je pourrai ne proposer à un adolescent dyslexique que de lire les débuts de textes avant de faire son choix.
Elle peut également évoluer.
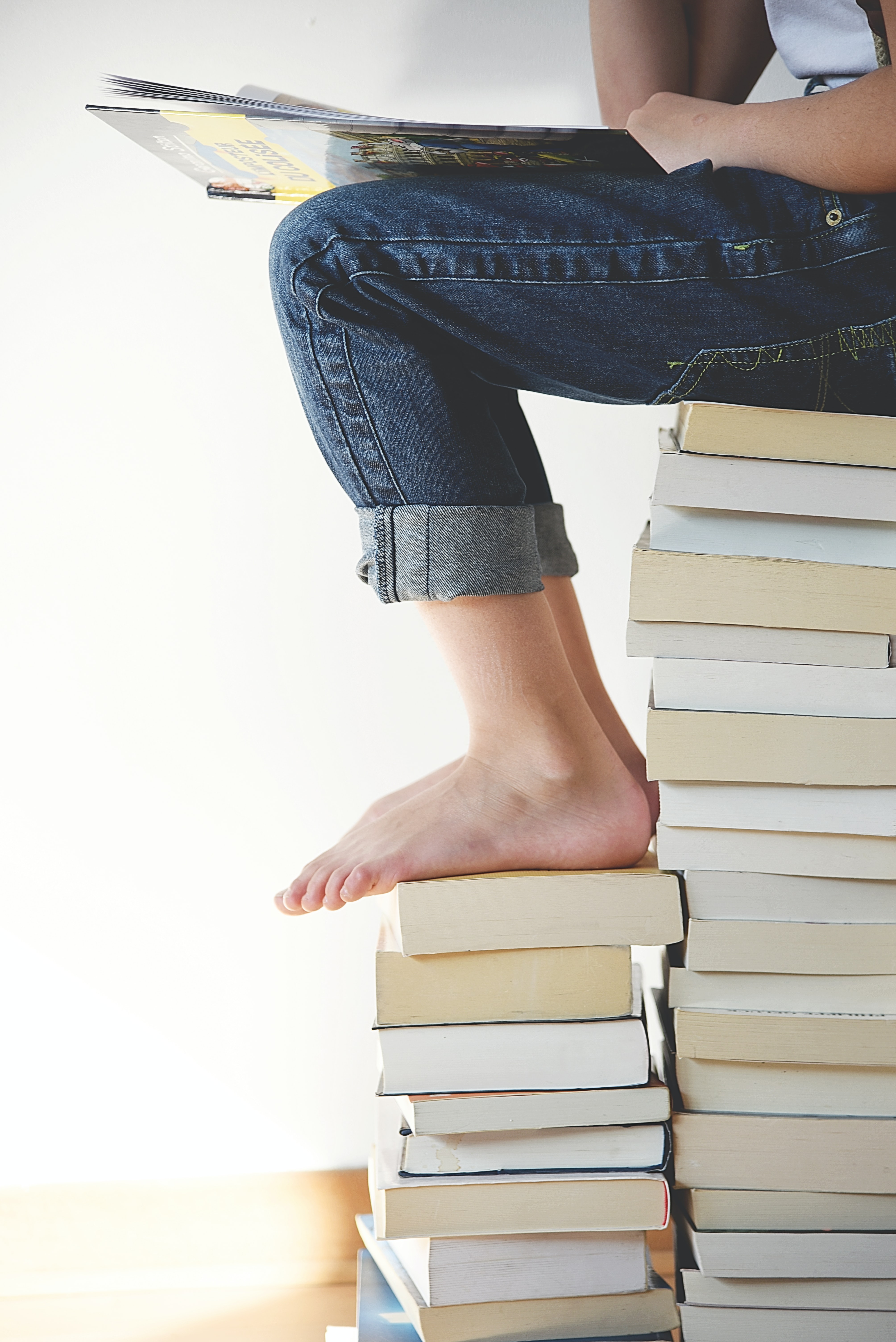 Le cas typique est celui de l’adolescent qui semble peu s’impliquer dans le travail de sélection, ou au contraire, celui qui, submergé par de nombreuses images, ne parvient pas à déterminer lesquelles il souhaite partager.
Le cas typique est celui de l’adolescent qui semble peu s’impliquer dans le travail de sélection, ou au contraire, celui qui, submergé par de nombreuses images, ne parvient pas à déterminer lesquelles il souhaite partager.
Il y a toujours 3 ou 4 textes au maximum qui sont présentés, dont un « texte de pause », qui n’est pas directement inspiré de la problématique du patient.
Cette consigne est réitérée à chaque présentation de textes.
-
Après la période de soins en expression scénique
Le bilan d’évolution permet de faire un point en fin de période. Nous décidons alors ensemble de la poursuite du suivi en fonction du degré d’atteinte de nos objectifs.
Nous pouvons reprendre l’orthophonie à l’aide de techniques plus classiques, ou bien décider de faire une pause, ou bien arrêter le suivi en orthophonie.
L’orientation vers d’autres thérapeutes peut également s’avérer plus adaptée à ce stade.